Le soir du 18 décembre 2004, dans le hameau de Madiran, dans le sud-ouest de la France, un homme nommé Jean-Luc Josuat-Vergès s’est égaré dans les tunnels d’une champignonnière abandonnée et s’est perdu. Josuat-Vergès, qui avait 48 ans et travaillait comme gardien dans un centre de santé local, était déprimé. Laissant sa femme et son fils de 14 ans à la maison, il s’était rendu dans les collines avec une bouteille de whisky et une poche pleine de somnifères. Après avoir dirigé sa Land Rover dans le grand tunnel d’entrée de la champignonnière, il avait cliqué sur sa lampe de poche et trébuché dans l’obscurité.
Les tunnels, qui avaient été creusés à l’origine dans les collines calcaires comme une mine de craie, comprenaient un labyrinthe de cinq miles de long de couloirs aveugles, de passages tortueux et d’impasses. Josuat-Vergès s’engage dans un couloir, tourne, puis tourne encore. La batterie de sa lampe de poche s’affaiblit lentement, puis s’éteint. Peu après, alors qu’il avance dans un couloir détrempé, ses chaussures sont aspirées et avalées par la boue. Josuat-Vergès a trébuché pieds nus dans le labyrinthe, tâtonnant dans l’obscurité totale, cherchant en vain la sortie.
L’après-midi du 21 janvier 2005, exactement 34 jours après que Josuat-Vergès soit entré pour la première fois dans les tunnels, trois adolescents de la région ont décidé d’explorer la champignonnière abandonnée. Après quelques pas dans le couloir d’entrée sombre, ils ont découvert la Land Rover vide, avec la porte du conducteur encore ouverte. Les garçons ont appelé la police, qui a rapidement dépêché une équipe de recherche. Au bout de 90 minutes, dans une chambre située à seulement 600 pieds de l’entrée, ils ont trouvé Josuat-Vergès. Il était d’une pâleur fantomatique, maigre comme un squelette, et avait laissé pousser une longue barbe hirsute – mais il était vivant.
Dans les jours suivants, alors que l’histoire de la survie de Josuat-Vergès atteignait les médias, il est devenu connu comme le miraculé des ténèbres, » le miracle des ténèbres « . »
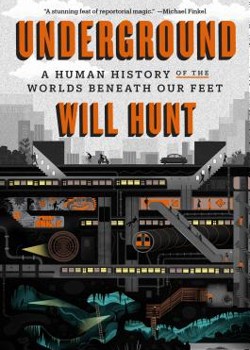
Il régalait les journalistes avec les histoires de ses semaines dans la ferme à champignons, qui semblaient rivaliser avec les plus grands récits d’alpinistes échoués ou de naufragés sur des îles désertes. Il mangeait de l’argile et du bois pourri, qu’il trouvait en rampant à quatre pattes et en tripotant la boue ; il buvait l’eau qui s’écoulait du plafond de calcaire, et parfois même l’eau des murs. Quand il dormait, il s’enveloppait dans de vieilles bâches en plastique laissées par les champignonnistes. La partie de l’histoire de Josuat-Vergès qui a dérouté les journalistes était qu’il avait subi des oscillations radicales et inattendues de son humeur.
Plus d’histoires
À certains moments, comme on pouvait s’y attendre, il sombrait dans un profond désespoir ; d’un morceau de corde qu’il avait trouvé, il avait même fabriqué un nœud coulant, « au cas où les choses deviendraient insupportables ». Mais à d’autres moments, explique Josuat-Vergès, alors qu’il marchait dans l’obscurité, il glissait dans une sorte de calme méditatif, laissant ses pensées s’adoucir et se dérouler, tandis qu’il embrassait les sentiments de désorientation, se laissant flotter dans les tunnels dans un détachement paisible. Pendant des heures, alors qu’il errait dans le labyrinthe, il disait : « Je me chantais à moi-même dans le noir. »
L’homo sapiens a toujours été un merveilleux navigateur. Nous possédons un organe puissant dans la région primitive de notre cerveau appelée l’hippocampe, où, chaque fois que nous faisons un pas, un million de neurones recueillent des données sur notre emplacement, compilant ce que les neuroscientifiques appellent une « carte cognitive », qui nous permet de toujours nous orienter dans l’espace. Cet appareil robuste, qui dépasse de loin nos besoins modernes, est un héritage de nos ancêtres chasseurs-cueilleurs nomades, dont la survie même dépendait de leur capacité de navigation. Pendant des centaines de milliers d’années, l’incapacité à localiser un point d’eau ou un abri rocheux sûr, ou à suivre les troupeaux de gibier et à trouver des plantes comestibles, entraînait une mort certaine. Sans la capacité de nous piloter à travers des paysages inconnus, notre espèce n’aurait pas survécu – c’est intrinsèque à notre humanité.
Lire : Quand le cerveau ne peut pas faire ses propres cartes
Il n’est donc pas surprenant que, lorsque nous perdons nos repères, nous soyons projetés dans une panique primitive et amère. Nombre de nos peurs les plus élémentaires – être séparé de ses proches, déraciné de son foyer, abandonné dans le noir – sont des permutations de la hantise d’être perdu. Dans nos contes de fées, c’est lorsque la jeune fille est désorientée dans la forêt lugubre qu’elle est accostée par le troll menaçant ou la vieille femme encapuchonnée. Même l’enfer est souvent représenté comme un labyrinthe, depuis Milton, qui a fait cette comparaison dans le Paradis perdu. L’archétype de l’histoire d’horreur de la désorientation est le mythe grec du Minotaure, qui habite dans les plis sinueux du Labyrinthe de Knossos, une structure, comme l’écrit Ovide, « construite pour disséminer l’incertitude », pour laisser le visiteur « sans point de repère ».
La peur de la désorientation est si profonde que se perdre pourrait déclencher une sorte de craquage, où notre sens même du moi se désagrège aux coutures. « Pour un homme qui n’y est absolument pas habitué », écrit Theodore Roosevelt dans son livre de 1888 intitulé Ranch Life and the Hunting Trail, « le sentiment d’être perdu dans la nature sauvage semble le plonger dans un état de terreur panique qui est effrayant à voir et qui, à la fin, le prive de toute raison… S’il n’est pas retrouvé au bout de trois ou quatre jours, il est très susceptible de devenir fou ; il fuira alors les sauveteurs et devra être poursuivi et capturé comme s’il était un animal sauvage. »
Dès notre premier pas dans l’obscurité souterraine, notre hippocampe, qui nous guide si sûrement dans le monde de la surface, se met en panne, comme une radio qui a perdu la réception. Nous sommes coupés de l’orientation des étoiles, du soleil et de la lune. Même l’horizon disparaît – si ce n’était de la gravité, nous aurions du mal à distinguer le haut du bas. Tous les indices subtils qui pourraient nous orienter à la surface – formations nuageuses, motifs de croissance des plantes, traces d’animaux, direction du vent – disparaissent. Sous terre, nous perdons même le guide de notre propre ombre.
En bas, dans le passage étroit d’une grotte, ou dans les plis délimités d’une catacombe, notre champ de vision est en œillères, ne dépassant jamais le prochain virage ou coude. Comme l’a fait remarquer l’historien des grottes William White, on ne voit jamais vraiment une grotte dans son ensemble, mais seulement un éclat à la fois. Lorsque nous naviguons dans un paysage, a écrit Rebecca Solnit dans A Field Guide to Getting Lost, nous lisons notre environnement comme un texte, en étudiant « le langage de la terre elle-même » ; le sous-sol est une page blanche, ou une page griffonnée d’un langage que nous ne pouvons pas déchiffrer.
Lire : Terra incognita
Non pas qu’il soit illisible pour tout le monde. Certaines créatures vivant dans les souterrains sont merveilleusement adaptées pour naviguer dans l’obscurité. Nous connaissons tous la chauve-souris, qui se faufile dans l’obscurité des grottes à l’aide d’un sonar et de l’écholocation, mais le navigateur souterrain par excellence pourrait bien être le rat taupier aveugle : une créature rose, ridée et aux dents bouclées – imaginez un pouce de 90 ans avec des crocs – qui passe ses journées dans de vastes nids souterrains en forme de labyrinthe. Pour naviguer dans ces passages sombres, le rat taupier aveugle tambourine périodiquement sa tête contre le sol, puis discerne la forme de l’espace en fonction des vibrations qui lui reviennent. Dans son cerveau, le rat possède même un minuscule dépôt de fer, une boussole intégrée, qui détecte le champ magnétique de la Terre. La sélection naturelle n’a pas doté les habitants de la surface de telles astuces d’adaptation. Pour nous, un pas sous terre est toujours un pas dans un vide de navigation, un pas dans la mauvaise direction, ou plutôt, pas de direction du tout.
Dans tout autre paysage, lorsque nos pouvoirs innés de navigation faiblissent, nous nous tournons vers une carte, qui nous ancre dans l’espace et nous permet de garder le cap. Dans le monde souterrain, cependant, la cartographie a toujours été une entreprise singulièrement perplexe. Bien après que les explorateurs et les cartographes aient cartographié tous les autres paysages terrestres de la planète, jetant des lignes de grille latitudinales et longitudinales nettes sur des archipels et des chaînes de montagnes éloignés, les espaces situés directement sous nos pieds sont restés insaisissables.
La plus ancienne carte connue d’une grotte a été dessinée en 1665 de la grotte de Baumann, une grande caverne dans la région densément boisée du Harz en Allemagne. À en juger par les lignes rudimentaires de la carte, le cartographe, un homme identifié comme Von Alvensleben, ne semble pas avoir été un cartographe expert, ni même capable, mais les lacunes de la carte sont néanmoins remarquables. L’explorateur n’a pas réussi à transmettre le moindre sens de la perspective, de la profondeur ou de toute autre dimension – il n’a même pas réussi à communiquer que l’espace est souterrain. Von Alvensleben a tenté de cartographier un espace qu’il était neurologiquement incapable de voir, un espace littéralement au-delà de sa perception. Il en est arrivé à une folie épistémologique, comme essayer de peindre le portrait d’un fantôme, ou d’attraper un nuage dans un filet.
La carte de la grotte de Baumann était la première d’une longue lignée de curieux échecs de cartographie souterraine. Pendant des générations, des explorateurs de toute l’Europe – des équipes d’hommes intrépides et chimériques – ont sondé des grottes dans l’intention de mesurer le monde souterrain, de s’orienter dans l’obscurité, mais ils ont échoué, souvent de manière déconcertante. Ils s’enfonçaient dans les profondeurs au moyen de cordes effilochées, où ils erraient pendant des heures, grimpant sur d’énormes rochers et descendant des rivières souterraines. Ils se guidaient à l’aide de bougies de cire, qui émettaient de faibles coronas de lumière ne s’étendant pas plus de quelques mètres dans toutes les directions. Les arpenteurs avaient souvent recours à des mesures absurdes, comme cet explorateur autrichien du nom de Joseph Nagel qui, pour tenter d’éclairer la chambre d’une grotte, attacha un ensemble de bougies aux pattes de deux oies, puis lança des cailloux sur les oies, dans l’espoir qu’elles prennent leur envol et projettent leur lumière dans l’obscurité. (Cela n’a pas fonctionné : les oies ont vacillé de façon boiteuse et ont dégringolé vers la terre.)
Même lorsqu’ils parvenaient à effectuer des mesures, entre-temps, la perception spatiale des explorateurs était tellement déformée par les caprices de l’environnement que leurs résultats étaient complètement à côté de la plaque. Lors d’une expédition en Slovénie en 1672, par exemple, un explorateur a sondé le passage sinueux d’une grotte et a enregistré une longueur de six miles, alors qu’en réalité, il n’avait parcouru qu’un quart de mile. Les relevés et les cartes issus de ces premières expéditions étaient souvent si éloignés de la réalité que certaines grottes sont aujourd’hui méconnaissables. Aujourd’hui, nous ne pouvons lire les anciens rapports que comme de petits poèmes mystérieux sur des lieux imaginaires.
Le plus renommé des premiers cartographes de grottes était un Français de la fin du XIXe siècle nommé Edouard-Alfred Martel, qui allait être connu comme le père de la spéléologie. Au cours d’une carrière de cinq décennies, Martel a mené quelque 1 500 expéditions dans 15 pays du monde, dont des centaines dans des grottes vierges. Avocat de profession, il a passé ses premières années à descendre en rappel sous terre en manches de chemise et en chapeau melon, avant de concevoir un kit d’équipement spécialisé pour la spéléologie. En plus d’un bateau de toile pliable baptisé Alligator et d’un téléphone de campagne volumineux pour communiquer avec les porteurs à la surface, il a conçu une batterie d’instruments d’enquête souterrains. Par exemple, il a inventé un dispositif pour mesurer une grotte du sol au plafond, dans lequel il attachait une éponge imbibée d’alcool à un ballon en papier au bout d’une longue ficelle, puis mettait une allumette sur l’éponge, ce qui faisait monter le ballon jusqu’au plafond au fur et à mesure qu’il déroulait la ficelle. Les cartes de Martel étaient peut-être plus précises que celles de ses prédécesseurs, mais comparées aux cartes dressées par les explorateurs de tout autre paysage à l’époque, elles n’étaient guère plus que des esquisses. Martel a été célébré pour son innovation cartographique consistant à diviser une grotte en sections transversales distinctes (ou coupes), qui allait devenir la norme en matière de cartographie des grottes.
Lire : Comment les cartes numériques ont changé ce que signifie être perdu
Martel et ses collègues explorateurs, qui ont passé des années à essayer et à échouer à s’orienter dans le monde souterrain, étaient des disciples de la perte. Personne ne connaissait aussi intimement l’expérience sensorielle de la désorientation : Pendant des heures, ils flottaient dans l’obscurité, pris dans un état de vertige prolongé, alors qu’ils essayaient et échouaient à s’ancrer. Selon toute logique évolutive, où nos esprits sont câblés pour éviter à tout prix la désorientation, où la perte active nos récepteurs de peur les plus primitifs, ils ont dû ressentir une profonde anxiété : « la terreur panique qui est effrayante à voir », comme l’a décrit Roosevelt. Et pourtant, ils sont descendus encore et encore.
Ils ont tiré une forme de pouvoir, semble-t-il, de se perdre dans le noir.
La perte a toujours été un état énigmatique aux multiples facettes, toujours rempli de puissances inattendues. À travers l’histoire, toutes les variétés d’artistes, de philosophes et de scientifiques ont célébré la désorientation comme un moteur de découverte et de créativité, à la fois dans le sens où l’on s’écarte d’un chemin physique et dans celui où l’on s’écarte du familier pour se tourner vers l’inconnu.
Pour faire du grand art, disait John Keats, il faut embrasser la désorientation et se détourner de la certitude. Il appelait cela la « capacité négative » : « c’est-à-dire quand un homme est capable d’être dans les incertitudes, les mystères, les doutes, sans aucune atteinte irritable après le fait et la raison. » Thoreau, lui aussi, décrivait le sentiment de perte comme une porte permettant de comprendre sa place dans le monde : « Ce n’est que lorsque nous sommes complètement perdus, ou retournés, écrivait-il, que nous apprécions l’immensité et l’étrangeté de la nature… Ce n’est que lorsque nous sommes perdus, en d’autres termes, lorsque nous avons perdu le monde, que nous commençons à nous trouver nous-mêmes, et à réaliser où nous sommes et l’étendue infinie de nos relations. » Tout cela est logique, d’un point de vue neurologique : Lorsque nous sommes perdus, après tout, notre cerveau est le plus ouvert et le plus absorbant.
Dans un état de désorientation, les neurones de notre hippocampe épongent frénétiquement chaque son, chaque odeur et chaque vue de notre environnement, se démenant pour trouver le moindre brin de données qui nous aidera à retrouver nos repères. Même si nous nous sentons anxieux, notre imagination devient prodigieusement active, évoquant des images ornementales de notre environnement. Lorsque nous prenons un mauvais virage dans les bois et que nous perdons de vue le sentier, notre esprit perçoit chaque craquement de brindille ou bruissement de feuille comme l’arrivée d’un ours noir en colère, d’une meute de phacochères ou d’un condamné en fuite. Tout comme nos pupilles se dilatent par une nuit noire pour recevoir plus de photons de lumière, lorsque nous sommes perdus, notre esprit s’ouvre plus complètement au monde.
À la fin des années 1990, une équipe de neuroscientifiques a traqué le pouvoir de la désorientation jusque dans les pièges physiques de notre cerveau. Dans un laboratoire de l’Université de Pennsylvanie, ils ont mené des expériences sur des moines bouddhistes et des nonnes franciscaines, où ils ont scanné leur cerveau pendant la méditation et la prière. Ils ont immédiatement remarqué un schéma : En état de prière, une petite région située près de l’avant du cerveau, le lobe pariétal supérieur postérieur, présentait une baisse d’activité. Il s’avère que ce lobe particulier travaille en étroite collaboration avec l’hippocampe dans les processus de navigation cognitive. D’après ce que les chercheurs ont pu constater, l’expérience de la communion spirituelle s’accompagnait intrinsèquement d’un émoussement de la perception spatiale.
Il ne faut donc pas s’étonner que les anthropologues aient repéré une sorte de culte de la perte traversant les rituels religieux du monde entier. Le savant britannique Victor Turner a observé que tout rite sacré d’initiation se déroule en trois étapes : la séparation (l’initié quitte la société en laissant derrière lui son ancien statut social), la transition (l’initié est en train de passer d’un statut à l’autre) et l’incorporation (l’initié revient dans la société avec un nouveau statut). Le pivot se produit dans la phase intermédiaire, que Turner appelle le stade de la liminalité, du latin limin, qui signifie « seuil ». Dans l’état liminal, « la structure même de la société est temporairement suspendue » : Nous flottons dans l’ambiguïté et l’évanescence, où nous ne sommes ni une identité ni l’autre, plus jamais mais pas encore. Le catalyseur ultime de la liminalité, écrit Turner, est la désorientation.
Parmi les nombreux rituels de perte pratiqués par les cultures du monde entier, un rituel particulièrement poignant est observé par les Amérindiens de Pit River en Californie, où, de temps en temps, un membre de la tribu va « s’égarer ». Selon l’anthropologue Jaime de Angulo, « le Wanderer, homme ou femme, évite les camps et les villages, reste dans des endroits sauvages et solitaires, au sommet des montagnes, au fond des canyons ». Dans l’acte de s’abandonner à la désorientation, la tribu dit que le vagabond a « perdu son ombre ». C’est une entreprise mercuriale que de partir en errance, une pratique qui peut aboutir à un désespoir irrémédiable, voire à la folie, mais qui peut aussi apporter un grand pouvoir, car le vagabond émerge de l’égarement avec un appel sacré, avant de revenir à la tribu en tant que chaman.
Le véhicule le plus omniprésent de l’égarement rituel – l’incarnation la plus élémentaire de la désorientation – est le labyrinthe. Nous trouvons des structures labyrinthiques dans tous les coins du monde, des collines du Pays de Galles aux îles de la Russie orientale en passant par les champs du sud de l’Inde. Un labyrinthe fonctionne comme une sorte de machine à liminalité, une structure conçue pour produire une expérience concentrée de désorientation. Lorsque nous entrons dans les passages de pierre sinueux et que nous nous concentrons sur le chemin délimité, nous nous déconnectons de la géographie extérieure, glissant dans une sorte d’hypnose spatiale, où tous les points de référence disparaissent. Dans cet état, nous sommes prêts à subir une transformation, où nous passons d’un statut social à un autre, d’une phase de la vie à une autre ou d’un état psychique à un autre. En Afghanistan, par exemple, les labyrinthes étaient au centre des rituels de mariage, où un couple solidifiait son union en parcourant le chemin de pierre sinueux. Les structures labyrinthiques d’Asie du Sud-Est, quant à elles, étaient utilisées comme outils de méditation, les visiteurs marchant lentement le long du sentier pour approfondir leur concentration intérieure. En effet, le récit archétypal de Thésée terrassant le Minotaure en Crète est finalement une histoire de transformation : Thésée entre dans le labyrinthe en tant que garçon et en ressort un homme et un héros.
Lire : Le renouveau du labyrinthe
Dans leur incarnation moderne, la plupart des labyrinthes sont bidimensionnels, leurs passages bordés par des empilements de pierres basses ou des motifs en mosaïque carrelés dans un sol. Mais en remontant la lignée du labyrinthe plus profondément dans le passé, à la recherche d’incarnations de plus en plus anciennes, nous constatons que les murs s’élèvent lentement, que les passages deviennent plus sombres et plus immersifs – en fait, les tout premiers labyrinthes étaient presque toujours des structures souterraines. Les Égyptiens de l’Antiquité, selon Hérodote, ont construit un vaste labyrinthe souterrain, tout comme les Étrusques en Italie du Nord. La culture pré-inca de Chavín a construit un énorme labyrinthe souterrain dans les Andes péruviennes, où elle organisait des rituels sacrés dans des tunnels sombres et sinueux. Les anciens Mayas ont fait de même dans un labyrinthe sombre de la ville d’Oxkintok, dans le Yucatán. Dans le désert de Sonoran, en Arizona, la tribu Tohono O’odham vénère depuis longtemps un dieu appelé I’itoi, également connu sous le nom d’Homme du labyrinthe, qui réside au cœur d’un labyrinthe. L’ouverture du labyrinthe d’I’itoi, un motif fréquemment tressé dans les paniers traditionnels de la tribu, serait la bouche d’une grotte.
Lorsque Jean-Luc Josuat-Vergès est entré dans les tunnels de la champignonnière de Madiran avec son whisky et ses somnifères, il avait eu des notions de suicide. « J’étais au plus bas, j’avais des idées très noires », c’est ce qu’il a dit. Après être sorti du labyrinthe, il a constaté qu’il avait repris goût à la vie. Il a rejoint sa famille, où il s’est trouvé plus heureux et plus à l’aise. Il a commencé à suivre des cours du soir, a obtenu un second diplôme et a trouvé un meilleur emploi dans une ville voisine. Lorsqu’on l’a interrogé sur sa transformation, il a déclaré aux journalistes que, pendant qu’il était dans le noir, « un instinct de survie » s’était manifesté, renouvelant sa volonté de vivre. Dans son moment le plus sombre, lorsqu’il avait désespérément besoin de transformer sa vie, il a voyagé dans le noir, s’est abandonné à la désorientation, se préparant à émerger à nouveau.
Ce billet est adapté du nouveau livre de Hunt, Underground : Une histoire humaine des mondes qui se trouvent sous nos pieds.